

Pour la plupart d’entre nous, le caractère définitif de la mort est une idée un peu floue. On grandit dans un cocon qui nous épargne jusqu’à notre vie d’adulte. Là, la perte d’un être cher nous prend au dépourvu mais c’est trop tard. Celui ou celle que vous aimiez n’est plus là. Vous croyez l’entendre, vous aimeriez le serrer dans vos bras mais tout est fini. Contrairement aux enfants de mon âge, j’avais compris que le temps m’était compté. Pourtant, quand la mort s’est acharnée sur mon sort, je n’ai pas su l’accueillir comme il fallait.
Chams Pricard
Rescapée de La Gorgone
Les notes ont été compilées, les interviews soigneusement classées, pour qu’on n’oublie pas le désastre de notre périple.


Titan, le pays de la nuit. Deuxième lune du système solaire, première en termes industriels, une population inégalement répartie sur quatre points stratégiques et, bien sûr, il a fallu que nous soyons débarquées dans la ville la plus peuplée et la plus pauvre de la planète. Purée de poisse ! Je regarde le bracelet que m’a remis l’agent des douanes.
— Ce bracelet, c’est ta vie, il me dit. Le perds pas !
Je sors de la fusée d’où la compagnie nous éjecte avec empressement, et je suis complètement éblouie. Des spots tracent dans toutes les directions et de la poussière s’élève de partout, on voit pas à dix mètres. Je remonte mon masque et j’avance, hésitante. Je discerne bientôt une flopée de véhicules qui attend.
— On va au dôme, me dit maman en me tirant par la main.

C’est à l’autre bout du désert, ça je le sais. Après, j’ai comme un trou de mémoire. Tout ce dont je me souviens, c’est de la nuit en plein jour, du sifflement du vent et du ciel aveugle que d’épais nuages orangés dévorent. J’ai les jambes flasques à cause du zombinol et je manque de tomber quand mon pied cogne contre une pierre. Par terre, les ombres sont courtes et les galets translucides. Peut-être de l’eau gelée. J’esquisse un geste pour ramasser celui sur lequel j’ai buté quand un soldat me presse de grimper dans le camion et de rejoindre les miens. Sinon, on va se perdre qu’il dit. Je suis maintenant au milieu des chars qui disparaissent à toute allure dans un épais brouillard brun terrifiant. Encore et toujours perdue. On m’appelle et je monte. Un silence épais, je baisse mon masque et je sens l’odeur de la peur des passagers, mélangée à celle du zombinol dont les effets commencent à s’estomper. Tout va plus vite que moi. L’instant d’après, le véhicule tangue et on roule. En démarrant, notre camion craque du bruit de la glace qu’il écrase sous ses énormes roues. Je me blottis contre ma cousine et je regarde par le hublot, captivée par un paysage qui refuse de livrer ses secrets. Éreintée, le nez collé à la vitre, je discerne enfin les stigmates de l’érosion, la terre est ridée par un ruisseau disparu qui a creusé ses sillons. Un éclair déchire soudain le ciel, derrière les nuages, accompagné d’un bruit de clairon, et la pluie claque sur les vitres. Le vent nous pousse violemment d’un côté, toujours le même, et le pilote doit ralentir quand j’aperçois dehors un animal trapu, de bonne taille et affreusement laid.
— Un chyène ! s’écrie un enfant près de nous, tout content.
Le militaire qui nous escorte hoche la tête, je ne peux pas voir son visage derrière son casque. J’interroge maman du regard, elle m’explique :
— C’est un croisement entre un chien et une hyène. Il peut supporter les bactéries locales et le méthane dans l’air.
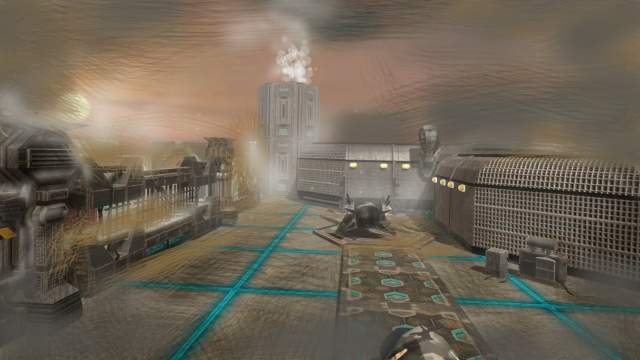
Elle me caresse les cheveux machinalement, des cernes bleutés sous les yeux, le voyage l’a éprouvée. Je regarde de nouveau au travers de la vitre à la recherche de la bestiole difforme, avec sa bosse velue sur le dos, sa gueule plate de bouledogue et ses crocs qui dépassent de la mâchoire. Mais c’est fini, il n’y a plus rien que les ténèbres brumeuses.
Après une bonne heure de route sous une pluie battante, on distingue enfin une demi-sphère translucide. Notre objectif. Une cloche avec quelques reflets. Un éclair fuse et le vrai déluge commence. Le blindé tangue de plus belle, cette fois on est secoués de droite et de gauche. Je vais vomir. Un sac tombe devant moi et joue au yoyo avec la ficelle. Maman le saisit et le pose sur mon visage. Je crache, mon estomac se retourne mais y’a rien dedans. Nous nous rapprochons. Le tank s’arrête et mon supplice s’achève. Même maman a le teint gris. Le militaire a sorti son arme sans que je m’en aperçoive et maman commence à s’agiter pour rassembler nos affaires : sac à dos, valises et gourdes. Le truc vite plié. Je cherche le toit de la cloche au travers du pare-brise, sans le trouver, car le ciel gronde toujours et un rideau de pluie s’abat sur nous. Temps de chiotte, qu’est-ce qu’on fout ici ? Les portes latérales s’ouvrent bruyamment et le soldat nous expédie sur le tarmac où des gardes armés jusqu’aux dents, nerveux, doigt sur la gâchette, nous attendent. Ils m’impressionnent par leur taille, leur épais manteau long et cintré qui flotte au gré du vent. Ils escortent notre descente et recherchent une cible mouvante en pointant fiévreusement leur supranuc vers le haut des bâtiments. L’un d’eux lance, au loin :
— C clean !
— Courez ! Go ! nous ordonne un autre.

Je prends maman par le bras et j’accélère le pas, un peu plus et encore un peu. Derrière nous, Coz et tatie nous suivent. Je tente de rassurer ma mère malgré la menace invisible mais, avant d’atteindre la porte, des tirs fusent au-dessus de nous. D’instinct, j’ai rentré la tête dans mes épaules et j’ai tiré maman contre moi en me dirigeant vers un rocher tout proche. Je n’ai pas eu un regard pour ma tante ni ma cousine, pas le temps. J’entends un bruit sourd, un sifflement brutalement amorti – un stouf – et tatie se met à hurler. Je retiens sa sœur qui se relève quand des militaires en uniformes viennent à notre secours et nous traînent de toutes leurs forces vers eux.
— Pourquoi ils nous tirent dessus ? interroge maman.
Je découvre pour la première fois ce visage étrange, recouvert d’une peau fine et pâle qui me dégoûte, avec des yeux délavés, presque aveugles. Un indigène.
Les tirs ont cessé et nous avons regagné le hall de l’héliport, essoufflées, mortes de trouille. Tatie est allée en observation à l’infirmerie où des nurses soignent sa blessure pendant que nous nous reposons sur des bancs, complètement vidées. On n’attend pas longtemps. Quand Pier réapparaît, nous rejoignons les autres voyageurs dans le grand hall, en traînant la patte. Personne autour de nous ne sait où aller ; quelle que soit leur langue, les arrivants montrent du doigt des directions opposées vers lesquelles personne n’ose avancer. Une bande de paumés qui fait pitié. Les sauvages, reconnaissables à leur chevelure blanche et leurs habits frustres, surveillent les sorties et scannent les arrivants. C’est humiliant. Qui est dominé à présent ? Ils portent des tenues de camouflage, mais je sais pas s’il s’agit de miliciens ou de militaires. Je me méfie. Ce sont eux qui nous ont tiré dessus ? Les fameux grounders ? Maman prend les choses en main.
— Sortez avant qu’un petit malin ne vole nos affaires !
Elle a accompagné ses propos d’une claque sur mon crâne. Nous progressons avec difficulté, essoufflées par la descente de zombinol, quand un naturel nous aborde.
— Need help ?
À vue de nez, je lui donne vingt ans. Je le détaille en un éclair. Pour le corps, il est grand et mince mais pas trop maigre non plus. Blond comme les blés, les cheveux courts et la peau diaphane. Un ange ! Pas du tout comme ce dégénéré de soldat sur le tarmac. Il porte une combi brune, incrustée de motifs jaunes en haut, qui recouvre ses hanches et ses fesses. Très moche en fait. Il porte aussi un blouson bien épais dans lequel on doit se sentir bien. Pas une peau de bête, un imprimé bien moelleux et si souple qu’on a envie de s’y lover. Un léger bourrelet à la taille me fait comprendre qu’il est armé. J’ai entendu parler de cette pratique, une milice privée se serait développée à Médiane pour protéger les habitants.
— Non merci, lui assure Pier, avec un geste de la main. On s’en sort très bien, notre fils va revenir d’une minute à l’autre.
Quel fils ? L’inconnu réplique par un rictus asymétrique et silencieux, sans insister. Il s’éloigne. Merde ! Mes yeux ne le lâchent pas et il me lance une œillade à laquelle je réponds sans le vouloir par un sourire niais. Quelle conne ! À voix basse, pour qu’on ne l’entende pas, maman confie à sa sœur :
— Tu y es allée un peu fort. On aura peut-être besoin de lui.
— Besoin de ces attardés ? Tu rigoles !

Maman me regarde, gênée. Tatie est raciste, tout le monde le sait. Pier est l’aînée de la famille, elle a un visage sévère et disgracieux avec son nez trop long et son menton en galoche. Toujours tirée à quatre épingles, elle compense sa laideur par une tenue sévère. Ce ne serait pas important si, par jalousie, elle n’était pas méchante avec maman, Cin, sa sœur cadette. Maman a tout, beauté et intelligence, tatie n’a rien. Maman ressemble à une actrice d’holoplexe ou à une madone de Raphaël, si ça peut vous aider. Teint pâle, traits à peine esquissés, yeux verts. Une mémoire d’éléphant et un esprit critique très développé. Trop d’ailleurs, ça nous a valu beaucoup d’ennuis. C’est en partie à cause de son tempérament tranché que nous en sommes réduites à espérer la charité de la part de ceux que nous avons écrasés dans une guerre sans merci. Nos ennemis d’avant. Et ça, tatie ne le supporte pas.
Coz, qui était partie devant, revient vers nous et désigne une porte droit devant. Elle a noué ses longs cheveux blonds en chignon, dégageant ainsi ses traits décidés, son nez droit et sa fine bouche teintée de fraise. Tatie l’adule, elle veut vivre à travers sa fille la réussite qu’elle n’a pas connue. Mais Coz tient tout ça de son père, un Nord-Européen. De lui, elle tient sa peau de porcelaine, ses yeux océan et ses joues rosées. Notre cortège avance, noyé dans la masse des égarés. Ma cousine soulage tatie du poids de sa valise, quand maman et moi traînons nos sacs comme des fardeaux. Ils ne sont pourtant pas gros mais nous sommes à bout de forces. Notre drôle de famille s’extirpe de la gare avec difficulté, en se frayant un chemin au milieu des détritus et des immondices qui jonchent le sol. Des tas de plastique, à hauteur d’homme, qui forment une haie et se déversent sur le parvis. La classe !
Ça y est, je me dis, on est dehors, ça nous a pris un temps fou mais on y est. Il n’y a rien pour nous, pas de navette ni de comité d’accueil. Il fait encore plus sombre sous un ciel bas aux épais nuages roux. Un éclair tonitruant sonne avec une pluie qui ne mouille pas mais qui claque de ses talons sur le dôme. J’ai levé la tête par réflexe en rentrant mon cou, la peur de me mouiller reste là. Comme je ne la suis plus, maman m’appelle et je regarde devant moi, pas très chaude à l’idée d’avancer. Partout, des tentes rafistolées s’agglutinent, cousues dans une matière molle. Elles ne laissent qu’un petit passage dans lequel on doit d’enfoncer. Pas le choix. C’est écrit « Hoboground », un endroit peu engageant, construit sans logique dans des matériaux recyclés. Je remarque les fines particules suspendues dans l’air et je note que les locaux protègent leur nez en enroulant un foulard dessus, comme les bédouins. Je crie :
— Mettez votre foulard devant votre visage !
On avance encore, en évitant de croiser des regards. Je suis horrifiée par le spectacle du bidonville et j’éprouve la sensation charnelle d’une misère contagieuse que je risque d’attraper comme on chope la syphilis. Nous entamons une marche en file indienne, nous arrêtant parfois, discutant peu, inquiètes d’être encerclées par les tentes. Au-dessus de nos têtes, le monde gronde toujours dans un boucan assourdissant. La nuit dans la nuit, toujours plus d’obscurité. Soudain, je prends conscience que je flotte.
— On se sent bizarre ici, remarque Coz au même moment.
— La gravité ! explique ma tante.

Tout a commencé par un enfant qui s’est jeté sur mon barda. J’ai à peine vu sa main sale plonger dans mon sac pour y voler ma brosse à cheveux. Fais comme chez toi, pouilleux ! Je me précipite à sa poursuite sous la tente la plus proche, sans réfléchir, propulsée par une puissance que je ne me connais pas. Je le rattrape ce cochon, mais alors que je le tiens, j’entends des voix s’élever derrière moi. Je me retourne, ma cousine est à terre, échevelée, et tente vainement de protéger le contenu de son paquet éventré. C’était un piège, qu’est-ce que je suis conne ! Nous sommes plus fortes, ils sont plus nombreux. Tellement nombreux que l’espace d’un instant je me sens abattue. Un rassemblement spontané s’est fait autour de Coz et son linge vole. On nous dépouille. Je lâche ce putain de gamin, bien remontée, et je me lance dans la bagarre pour rattraper nos frusques qui circulent de bras en bras. Des hommes et des femmes se disputent nos biens comme s’il s’agissait des leurs. Ils puent, c’est une horreur, et leurs traits sont ceux de fous : les yeux exorbités, le regard avide et la bouche emplie d’insanités. Du Jérôme Bosch en puissance dix. Tous clochards, tous Titaniens. Soudain, un coup de nuc claque, la foule se dissipe et il ne reste au sol qu’une vieille valise vide. Maman me gifle si fort que je tombe par terre, la joue en feu, honteuse d’être responsable de notre malheur.
— Oh pardon, ma chérie !
Je ne la reconnais plus, elle est dévastée, des larmes inondent son visage fatigué. Elle me fait peine, j’avoue comme un bébé qu’on a grondé trop fort :
— C’est moi, c’est ma faute.
Je reste le cul par terre jusqu’à ce qu’une main ferme m’agrippe pour m’aider à me relever. Je reconnais alors l’indigène rencontré plus tôt dans la gare, nuc à la main, et ça me remonte le moral.
— C’est toi qui as tiré ?
— Ouaip. Angelo, C mon nickname.

Je passe sans transition du désespoir à la joie. Cette fois, je prends le temps de l’observer et je fais en sorte qu’il le voie. Grand et mince ça oui, des épaules larges qui en imposent. Il a aussi de grandes mains fines et propres, pas celles d’un travailleur, celles d’un chef. Seuls ses yeux azur dépassent de son keffieh. Il a un regard doux qui me caresse à distance et je le lui rends d’un battement de cils. En plus, il sent bon. Il nous aide en silence à remettre nos affaires dans les sacs, récupérant ce qu’il peut sur les piquets des auvents, dans les mains des clodos, pendant que quatre autochtones en armes les tiennent en respect. Sans un mot, Angelo ouvre la route et notre triste convoi quitte cet endroit abominable, plein de crève-la-faim poussés à se comporter comme des bêtes. Une fois à l’abri de ces sauvages, notre protecteur désigne l’angle d’une rue :
— Ici C safe, qu’il promet dans son patois local.
Il fait bon, l’orage a cessé de nous tourmenter et un éclairage public nous a suivis jusque là. Il bourdonne autour de nous, éclaire le visage de maman, mangé par la pénombre.
— Il fé toujours chienloup, précise Angelo.
— C’est quoi ? je demande.
— C ni le jour, ni la night.
Je regarde autour de nous, le quartier aux immeubles bas est à peu près propre, mais je reste imprégnée de la crasse de l’héliport. Ce n’est pas tant le souvenir de l’odeur qui me gêne, que la vision hallucinante des monticules de poubelles dans chaque recoin. Il faut que j’oublie ça. Nous sommes installées à l’extérieur, sur des caisses prêtées par la bande d’Angy, à côté de nos valises, blotties les unes contre les autres, sans comprendre ce qui nous arrive. Avant de partir, il a salué ma mère avec ce signe de respect qui part du front pour se diriger vers l’autre.
— Be cool !
Je m’assois contre le mur du bar qui nous sert d’appui et je le caresse machinalement. Il est doux comme une peau et froid comme de l’acier, coulé dans un béton particulier. Une sorte de régolithe, je pense. En face, un patchwork d’échafaudages s’étire sur les murs et sert d’escaliers ou de couloirs de circulation à des visiteurs improbables. Et pourtant, l’endroit doit s’animer à un moment de la journée car, près de l’entrée de la taverne où nous nous trouvons, des déchets jonchent le sol en dalles, rappelant à s’y méprendre celui de Massilia. Il y a de la vie ici. J’examine de plus près des affiches clignotantes qui annoncent la venue de stars locales, comme à la maison. C’est drôle d’imaginer ces indigènes danser sur de la musique algorithmique. Je me demande à quoi ressemble leur son. L’aspect rapiécé du quartier en dit long sur sa construction improvisée, faite par à-coups, sans plan initial. Sauf que, lorsque je jette un œil curieux sur l’artère principale à l’angle de notre rue, je tombe sur un trou dans le ciel, comme un rideau de théâtre qui s’ouvre sur Saturne. Elle est curieusement inclinée et le spectacle de ses anneaux scintillants me subjugue. Je me trouve insignifiante.

J’embrasse maman qui tombe littéralement de sommeil et je monte une tenture avec des pieux prêtés par les locaux, avant de m’installer pour dormir sous une couverture de survie.
Épuisée et encore un peu droguée par le zombinol, je n’ai pas tourné longtemps avant de m’endormir. D’un côté, puis de l’autre, puis plus rien. J’ai sombré pour immédiatement rêver de papi que nous avons laissé derrière nous, sur Terre. J’aurais tout donné pour rester avec lui, dans sa maison mal chauffée au milieu de la campagne massilienne. Malgré le froid, papi nous emmenait chasser l’écureuil, l’une des rares proies à avoir survécu au grand hiver et aux contaminations. Dans mon rêve, il m’explique :
— Tout ce qui a survécu est minuscule. Ils ont pas besoin de beaucoup manger.

J’adorais partir avec lui sur des sentiers escarpés, écouter le craquement des branches mortes et celui de nos pas sur le sol mouillé. Dans mon songe, toujours, une rivière s’affole le long du chemin, le froid lui a pris toute son eau et le peu qui reste claque sur des cailloux.
— L’eau se rétracte ! me dit papi.
Il m’attend sur l’autre rive et j’essaie de traverser la rivière en sautant sur de grosses pierres mais il me rappelle à l’ordre.
— Tu vas glisser !

Et là, le rêve se transforme en cauchemar. Des arbres poussent partout, que je ne connais pas, très hauts avec des feuillages roses. Je lève la tête pour les regarder pousser et quand je fixe de nouveau mon grand-père, son visage se transforme et son corps s’étire. Là, il se métamorphose en une drôle de créature, deux fois plus grande que moi, avec un visage étiré, deux trous à la place du nez et d’immenses yeux qui lui mangent la face. Je crie, du moins j’essaie, sans pouvoir bouger. Le géant s’avance vers moi, je reste figée. J’appelle à l’aide et, pour finir, je me réveille.

Je suis debout la première, vierge des souvenirs affreux de la veille, mais bouleversée par l’apparition maléfique de mon grand-père dans mon imagination. Qu’est-ce que ça veut dire ? Peut-être que mon cerveau veut m’aider à me couper du monde d’avant. Peut-être que je devrais faire le deuil de mes grands-parents. Grandir et admettre que je ne les reverrai jamais.
Les flocons blancs qui dansent devant moi, suspendus dans l’atmosphère artificielle, me rappellent que je me trouve sur Titan. Le jour ne s’est pas vraiment levé parce que la nuit ne s’est pas tout à fait couchée. Près de nous, d’autres Terriens ont fini dans la rue, allongés sur leurs bagages et leurs soupirs m’indiquent qu’ils dorment encore. Je suis tiraillée entre ma fascination pour Titan et le chagrin de maman, mais je suis bien décidée à la convaincre que Médiane est notre nouveau chez nous. Quelle heure il se fait ? Mon transmetteur ne transmet plus rien du tout. Je sais que Titan met seize jours TE pour tourner sur elle-même et autour de Saturne et que je dois me fier à mon biorythme pour décider des alternances jour et nuit. Ce matin – enfin, en heures TE – j’ai la patate. J’ai bien récupéré de la fatigue des jours précédents. Il faut dire que l’image de mon sauveur me revient à l’esprit et me met d’excellente humeur. Pour être honnête, j’ai le sentiment de vivre une aventure extraordinaire dont je suis l’unique héroïne. Toute l’action de mon film imaginaire converge vers ma petite personne, et j’ai hâte de visiter cette ville exotique. Une fois debout, je ressens les effets d’une gravité moins forte que sur Terre, même si la pression atmosphérique la compense un peu. J’ai envie de bouger mais les alentours sont toujours déserts. Des commerces, d’énormes tuyauteries s’échappent et refoulent de buée inodore, absente des toits à notre arrivée. La ville se lève. J’interroge doucement Coz qui s’étire :
— Tu sais à quoi nous donnent droit ces bracelets ?
Les cheveux en bataille, les yeux mi-clos, elle se contente de secouer la tête pour se recoiffer.
— J’ai mal dormi.
— T’as fait un cauchemar toi aussi ?
Elle fait non de la tête, noue son chignon en remontant une longue tresse derrière qu’elle met en boule avant de laisser deux boucles retomber sur le côté. Puis, c’est au tour de ma mère d’ouvrir un œil paresseux et je lui propose aussitôt d’aller chercher le petit-déj. Elle accepte, un peu pour se débarrasser de moi. Je déambule dans les rues du quartier, intimidée et excitée à la fois et, à force de circonvolutions, je finis par tomber sur une file d’attente qui m’intrigue. Au bout de la queue, un vieillard maigrichon, le dos vouté, me dépasse d’une bonne tête. Ses épaules sautent à chaque fois qu’il tousse.
— Vous attendez quoi ? je lui demande.

L’homme se retourne et je découvre un enfant, foulard sur la tête, visage dégagé. Il tient un verre dans la main et me fait un clin d’œil sans un mot, puis il désigne du doigt une affiche qui représente un bol de nouilles avec des baguettes. Je lui montre mon bracelet et j’élabore un langage des signes que je crois universel pour demander si on peut acheter une ration avec ça. Le garçon acquiesce sans m’adresser la parole. Soit il comprend pas le Terrien, soit il aime pas les étrangers, soit je sais pas. Je plonge mon regard dans l’océan de ses yeux clairs pour me faire une idée et j’y vois quelque chose de gentil. Alors, ça va. Il souffle entre ses dents, il ne siffle pas vraiment, il refait le son du vent. Sa mélodie aussi me dit qu’il est tranquille et que je n’ai rien à craindre de lui. Ses gestes lents s’enfoncent dans ses poches ou se posent sur ses hanches, ou encore sur son front. On avance, on se rapproche de la soupe et je sens son odeur. De temps à autre, le regard placide du garçon se pose en douce sur moi, puis sur la ville et le ciel. J’ai entendu dire que la dégénérescence des Titaniens s’expliquait par une faible luminosité sur la planète, protégée des rayons solaires par une atmosphère opaque. Quant à leur grande taille et leur allure dégingandée, elles découleraient d’une gravité plus faible que sur Terre. Je suis postée derrière lui et je suis son chant si particulier, interrompu par de brefs toussotements. Je me retourne et il y a maintenant un peu de monde derrière moi. La file d’attente se compose d’autant de sauvages que d’immigrés, les premiers se distinguant des seconds par une tenue vestimentaire assez simples. Je suis fière d’avoir trouvé ce point de ravitaillement d’où je pourrai certainement ramener à manger pour deux. Mais Coz devra revenir avec moi pour les rations suivantes. La princesse. Si sa mère veut bien qu’elle m’aide dans ces tâches subalternes. C’est pas de sa faute à Coz si sa mère la vante tout le temps, mais je n’aime pas qu’on me rabaisse. De toute façon, Coz elle prend des baffes alors je l’envie pas trop. C’est au tour de l’indigène devant moi. Il prend des nouilles pour lui puis il saisit mon poignet et montre mon bracelet au cuisinier qui me remplit un bol.

— J’en veux deux, un pour ma mère aussi.
Finalement, je demande à l’inconnu :
— Tu t’appelles comment ?
Mais en guise de réponse, il cogne son verre contre le mien puis le porte à ses lèvres. Nous aussi on fait ça sur Terre. Soudain, des gens s’arrêtent près de nous et, bientôt, des écrans s’allument sur les murs des maisons. Je ne suis pas connectée mais je peux lire les commentaires sous les images. On voit une sorte de tache sphérique noire devant Jupiter. La géante est reconnaissable entre mille, impossible de la louper. Plus grosse et plus massive que toutes les autres planètes réunies, un véritable aspirateur à météorites. Et pourtant, c’est écrit, une tache brune est apparue devant elle, qui refuse de bouger. Je regarde autour de moi, les gens se tiennent immobiles, regardant sur leurs lunettes un écran invisible pour moi. Je me retourne vers le Titanien, même lui est augmenté, tout pauvre qu’il est. Il a suspendu son geste, sa soupe à la main. J’observe la scène, fascinée, puis je me rapproche du mur-écran tout décrépi et je poursuis ma lecture. Il y a à présent un homme en blouse blanche qui parle, l’air excité. Le sous-titre explique qu’il s’agit du professeur Auber, un astrophysicien. Il a remarqué que la tache reste immobile, comme posée devant Jupiter. Puis, un autre gars s’exprime. Lui dit que c’est probablement un astéroïde. Ça a l’air important, on n’entend plus aucun bruit. J’ai une impression de fin du monde. Et puis j’ai compris. Un schéma montre l’astéroïde à droite, la Terre à gauche et une ligne droite en pointillés qui relie les deux astres. Oh punaise ! C’est énorme ! Je les ai tous laissés là dans leur stupéfaction et je suis retournée en vitesse voir maman.

Une heure que je traîne, je me suis perdue, un bol dans chaque main. Impossible de rejoindre le bar quand, enfin, je reconnais au loin son logo : une noix de macis, torsadée et ajourée, par référence à un alcool très en vogue dans Sol. Je rejoins maman qui a réajusté la toile plastifiée et je lui tends ses nouilles, le deuxième bol est pour Pier.
— Premier repas sur Titan ! déclare-t-elle.
— Faut faire tourner les bracelets. Je viens de consommer deux rations de repas sur trois.
Maman a retrouvé le sourire.
— Bravo ! Tu te débrouilles bien.
Rien ne pourrait entamer ma bonne humeur qui, j’aime le croire, est contagieuse. Une fois Coz bien réveillée, je raconte l’histoire de l’astéroïde.
— Si ça se trouve, on a bien fait de quitter la Terre, avance maman.
Personne n’y comprend rien. Je décide de partir à la recherche des bains publics auxquels nous avons libre accès, un luxe quand on sait que la seule eau disponible sur Titan provient des glaciers. J’ose proposer que Coz fasse la queue de son côté pour de nouvelles rations.
— Pas question, j’ai peur qu’il lui arrive quelque chose, dit tatie.
Je suis vexée.
— Et à moi ? T’as pas peur qu’il m’arrive quelque chose ?
— Toi, tu es dégourdie, elle me lance.
Comme si Coz était une cruche. Dis plutôt que je suis le larbin de la famille. Ma cousine prend son air de chien battu, elle aimerait venir avec moi.
— Coz m’accompagne à la mairie remplir les papiers d’immigration, poursuit Pier. Cin, tu gardes nos affaires.
Elle donne des ordres à maman maintenant ! Ça sert à rien de jouer les grandes sœurs, vu la merde dans laquelle on est. Je lance :
— Coz, passe-moi ton bracelet, faut que je mange quelque chose sinon je réponds plus de rien.
Là, tatie est d’accord. Ça ne la gêne pas, tant que sa fifille reste avec elle. Je repars faire la queue et je fais bien attention à me repérer dans mes déplacements. Les nouilles sont délicieuses, je les aspire bruyamment en éclaboussant ma combi. Au retour, je tombe sur le jeune Titanien que j’avais rencontré plus tôt.

— Alors, tu t’appelles comment ? Moi, c’est Chams.
Il me fait un salut avec la main qui part du front pour venir vers moi.
— Moi C Cerk. Tu fé koi ?
— Alléluia ! Il parle !
Une boutade qu’il comprend. Je découvre sa voix étranglée, envoûtante et délicate, aussi gentille que son chant.
— Je voudrais prendre une douche.
— La douche, C nice. Suis-moi.
Il marche tranquillement, les mains dans les poches. J’aime bien son rythme, à quoi bon se presser ? Il désigne un bâtiment qui ne paie pas de mine, recouvert de régolithe, signe qu’il s’agit d’une habitation primitive, construite par les pionniers. Il me file quelques tuyaux.
— C gratos pour les kids. Tu peux checker each day. Mé pour lé grands, fo dé médiènes, dé vrais.
Il frotte son pouce contre son index.
— Les médiènes, c’est les sous d’ici ? je demande.
— Ouaip.
Je rentre une demi-heure plus tard. D’autres migrants trainent dans les rues, je les observe en chemin et je leur fais signe en passant, avec un plissement d’yeux exagéré qui les renseigne sur le sourire dissimulé derrière mon foulard. Et là, je me rends compte qu’il y a surtout des femmes parmi les adultes. Trop de femmes sur Terre, ils nous expédient dans les colonies peuplées essentiellement par des hommes, des soldats et des ouvriers. Enfin, je rejoins maman à l’angle de notre rue, Tatie et Coz sont déjà de retour. Je préfère annoncer la mauvaise nouvelle tout de suite :
— Les grands doivent payer pour se laver.
Tatie renchérit :
— Et nous devons aussi payer une taxe pour l’air.
— Avec quoi ?
Pier a écarté les bras et levé les yeux au ciel en faisant la moue.
— Je sais pas.
Je ne réfléchis pas longtemps.
— J’ai rencontré un garçon, Cerk, il fait la manche toute la journée. Je vais faire pareil.
— Hors de question ! crie maman. Je vais trouver un travail.
Elle tousse jusqu’à s’étouffer.
— Tiens !
Pier lui tend sa gourde.
— Cin, c’est provisoire. On n’a pas le choix !
Coz n'aime pas sa soupe et l'a troquée contre du pain local, une galette pas très épaisse et insipide mais qui bourre bien l'estomac. Il y en a assez pour notre repas du midi qui se fait sur le pouce. C'est dégueu, la pâte colle aux dents, mais on va pas faire les difficiles. Le quartier est de plus en plus animé, les Terriens juste débarqués sont tous entassés dans la même rue que nous. Les indigènes ne nous remarquent même pas et ne semblent pas très curieux. Après manger, Coz et moi partons faire la quête dans des rues éloignées de notre bar. Ne pas se perdre, noter les repères sur notre calepin. Peu à peu, un plan de la ville se dessine. Pas très précis mais suffisant pour l'usage qu'on en fait. À droite et après à gauche, le kiosque à nouilles, si on revient sur nos pas et qu'on s'enfonce dans une ruelle les douches publiques. Une enseigne les désigne d'un logo avec un robinet. Impossible de faire la manche dans ce coin, un sauvage, encore plus pauvre que nous, nous a chassées en nous menaçant d'un bâton. Je crois que l'endroit est à lui et je crois surtout que tous les spots pour faire la manche sont pris. Partout où nous nous installons, des clochards nous chassent. Nous croisons d'autres petits migrants qui nous imitent sans succès. On revient sur nos pas et on voit au loin nos mères qui patientent sous notre toit de fortune. Elles sont en grande discussion. La rue sur notre gauche rejoint le marchand de nouilles, on ne l'a pas explorée jusqu'au bout. On croise mon nouveau copain.
— Cerk, je te présente Coz, ma cousine.
— Hi la couz !
Sa voix éraillée est celle d’un enfant qui hésite entre la joie et la tristesse, la réticence et l’engagement. Mais j’ai bien vu comment il l’a regardée. Coz lui plait, c’est sûr. D'un coup, c'est l'évidence même : ma cousine se rapproche des critères de beauté titaniens avec sa peau laiteuse, ses yeux clairs et sa chevelure blonde. Je sais qu’elle n’a jamais eu de copain, je la sens intimidée.
— Coz et moi, on est chassées partout où on va. On n’arrive pas à faire la manche plus de cinq minutes.
C’est encore lui qui nous sauve mais cette fois, il le fait pour Coz qu’il ne quitte plus des yeux. Il désigne le bout de la rue sur notre droite, à l’opposé de la gare.
— Par là !
— Merci !
Je l’embrasse sur la joue et je perçois cette micro-expression titanienne qui peut se rapprocher d’un vague sourire. Coz lui fait un petit signe de la main, puis nous partons en courant. La faible gravité nous fait oublier notre fatigue et on arrive rapidement à l’endroit indiqué, un quartier magnifique, neuf, avec quelque rares riverains. Vous croyez qu'ils seraient désolés de voir deux gamines mendier ? Pas du tout. On est une attraction touristique. Les uns nous demandent d'où on vient, de quel endroit sur Terre, les autres confrontent leur patois au nôtre. Un jeune à un moment nous fait écouter des sons locaux, une musique gisement qu'il dit, composée uniquement de sons miniers produits par des machines-outils. On oublie notre misère un instant et il a l'air content. Tous les passants sont des hommes, quand j’y repense. Au bout d’un moment, on croise Cerk qui demande :
— Pourkoi, kils envoient que des girls, les Terriens ?
On sait pas trop quoi dire, c'est Coz qui répond.
— Ben en fait, à cause des pesticides et tout, y'a moins d'hommes sur Terre et plus de femmes. Alors, ils préfèrent renvoyer en priorité des femmes. Le réajustement, ils appellent ça.
On le quitte et Coz me confie :
— J’aimerais passer du temps avec lui.
— Si tatie l’apprend, elle va te donner une sacrée rouste, toute grande que tu es.
— J’ai seize ans, elle se rebelle. On voit des garçons à seize ans.

À notre retour, maman ordonne une séance de lecture. La fête est finie. Elle veut ponctuer nos journées de rituels qui rappellent ceux de la Terre, car la nuit s’obstine à ne pas tomber. Elle a dans son trans une bibliothèque impressionnante et nous partons pour une soirée où nos voix se croisent. Je renâcle. Elle n’a pas pu emporter ses toilettes mais t’inquiète qu’elle n’a pas oublié les livres. On est vraiment maudites. Les migrants autour de nous entament eux aussi leur vie nocturne, et on entend les gamelles tinter. Fascinée par les récits de voyages, maman nous fait lire Saint-Exupéry. On se souvient tous de ce dessin, un trait et une bosse, le mouton dans le serpent. Pour moi, ça a été une révélation. Pendant les soirées de lecture, nos mères nous font endosser chacune un rôle et, alors que la nuit ne veut toujours pas tomber, nous commençons le cérémonial du coucher. Je suis Saint-Ex et Coz le petit garçon.
— Que fais-tu là ?
— Je bois.
— Pourquoi bois-tu ?
— Pour oublier.
— Pour oublier quoi ?
— Pour oublier que j’ai honte.
— Honte de quoi ?
— Honte de boire.
Je relève la tête et demande à ma mère.
— Pourquoi il a honte ?
— Je sais pas, tu en penses quoi ?
Et voilà que commence la veillée. Nous lisons, nous parlons, nos mères racontent, et enfin, nous dormons.

Je me suis effondrée sur mon sac de couchage comme la nuit précédente, sans me faire prier. Je dormais d'un sommeil lourd quand les images du cauchemar de la veille sont réapparues, un peu comme si je reprenais un film exactement où je l'avais laissé. Mais la créature n'est plus là, il y a papi à la place. Il se tient devant moi, détendu quand, brusquement, je me souviens que je dois déménager et que je suis en retard, ce qui a pour effet de modifier instantanément le paysage. Cette fois, les racines des arbres sortent de terre et créent des voies de circulation qui partent dans tous les sens. Je ne sais plus laquelle je dois prendre. Par dépit, j'en choisis une au hasard et je me mets à marcher au creux d'une racine qui ressemble à une énorme liane. Je laisse mon grand-père derrière moi, je lui fais un signe de la main. Et là, nouvelle évidence : ma valise est vide et où je vais il fait froid. Je n'aurai rien à me mettre. Mais je vais où au fait ? Ça y est, ça me revient, je vais en Amérique ! D'ailleurs, je la vois. Elle se construit tout autour de moi, quelque chose qui pourrait ressembler à New York. Les immeubles sont si hauts et moi si petite que le sol est incurvé, comme une route qui monte derrière laquelle dépassent le haut des immeubles. Je cherche une boutique pour m'habiller, je cherche encore et encore mais je ne trouve pas. Je m'enfonce dans des rues de plus en plus étroites et, inévitablement, je me perds. Je suis seule dans le noir, sans savoir où loger, sans argent. Si seulement j'étais restée avec mon grand-père. C'est là que la créature réapparaît. Elle est loin, j'en ai moins peur mais quand même, je suis pas tranquille. Elle me fait signe et je m'approche, pourtant je n'en ai aucune envie mais je ne peux pas lutter. Là, l'angoisse me saisit et je me réveille. Putain, pourquoi y’a l’Amérique dans mon rêve ? J’émerge peu à peu, je me retrouve dans un sac de couchage que nous a donné Cerk. Un duvet bien chaud. La rue est sombre et tous les Terriens dorment tandis que les autochtones s’affairent encore dans les rues adjacentes. C’est peut-être pour ça qu’on nous a regroupés ici, pour qu’on soit tranquilles. Clairement, notre biorythme et le leur sont différents. Maman, tatie et Coz dorment toujours. Je me rallonge, j’ai sommeil. C’était beau l’Amérique dans mon rêve. On aurait dit que les immeubles gonflaient derrière une route bombée. Je fais le lien avec papi. C’est peut-être encore lui qui se cache derrière ces images. Il avait l’habitude de prétendre qu’il m’emmenait en Amérique quand on allait acheter du pain. Ce voyage extraordinaire commençait au bout de la rue. J’étais petite, je n’avais pas le droit de sortir seule, c’était mon moment de liberté. Papi était un taiseux, seule figure paternelle dans notre clan de femmes, et avec lui je me tenais à carreau. Ma main dans la sienne, nous prenions des chemins cotonneux pour nous rendre dans la rue principale. Avant de sortir, nous superposions des couches de vêtements qui nous tenaient chaud mais cette accumulation de frusques pesait si lourd que nous progressions lentement, le souffle coupé par les températures négatives. Moins six degrés Celsius, un temps clément par rapport à celui de la capitale. Je me souviens de l’épicerie où m’abandonnait pépé pendant qu’il faisait ses courses, un endroit que je détestais, géré par une vieille acariâtre qui m’accueillait avec une grimace et me regardait d’un œil torve. Madame sourire que je l’appelais. Je suivais scrupuleusement ma liste de commissions, avant de me rendre à la caisse. Un moment douloureux, où madame Sourire me mettait mal à l’aise. Je lui tendais le bracelet que papi me confiait et j’utilisais la monnaie pour acheter des sucreries, des bonbons savoureux que je partageais avec Coz. Je ne sais plus où se rendait mon grand-père exactement. Au cybercoop, au bankomat ? Toujours est-il que je n’avais pas longtemps à attendre avant de le retrouver pour prendre le chemin du retour. Je me suis rendormie, calmée par un sentiment de sécurité.
Nouvelle journée, nouvelles routines : plus d’école, plus de couvre-feu mais, à la place, la quête et les longues files d’attente. Les vacances ! Mes premiers jours sur Titan sont ainsi marqués par le sceau de la liberté. Maman a cependant entendu parler d’une école expérimentale, créée dans la rue par des parents qui sont venus la démarcher. La poisse ! Nos mères ont évidemment décidé de nous y envoyer une heure chaque matin mais nous garderons les après-midis pour la quête, car nous ramenons beaucoup de médiènes. Maman s’est impliquée dans l’asso pour enseigner le français. Tatie a ravalé sa fierté et accepté que Coz m’accompagne, car il n’est pas question que je me promène seule sans escorte. Tous les vieux dans notre rue ont pris la même décision, pendant ce temps un adulte va à la mairie produire les documents nécessaires à l’immigration et un autre s’occupe de l’intendance, c’est-à-dire laver le linge et chercher un dortoir pour la nuit.

Désormais, Cerk nous accompagne dans nos déambulations. Il vit dans un hangar avec d’autres enfants des rues qui ont perdu leurs parents pendant la guerre du Split ou dont les parents ont été déportés sur la ceinture. Je pose à Cerk une question qui me tarabuste depuis longtemps :
— Cerk, elle est où ta famille ?
— G nobody, tous gone. Ma mum elle est dead de la maladie de la cloche.
— Et ton père ?
— Le dad, il a été envoyé in jail sur la belt. Il est revenu exhausted et il a clamsé direct.
— Pourquoi en prison ? demande Coz.
— Il a fait la fight contre l’Empire.
Nous nous taisons, nous avons été élevées dans la croyance en la supériorité de l’Empire, ce dont nous commençons fortement à douter. C’est comme si nous avions traversé un écran pour mieux voir l’envers du décor. La Terre nous a abandonnées et aujourd’hui un Titanien nous aide. Hier, il était notre ennemi, aujourd’hui cet ennemi a un visage et ce n’est pas de lui dont j’ai peur. Malgré mon jeune âge, je commence à nourrir de la rancœur pour cet Empire pour lequel mon père biologique travaillait. Je sais vraiment pas pourquoi maman et tatie s’obstinent à rester du mauvais côté des combattants. J’ai un peu honte, mais Cerk ne nous en veut pas. Dans la conversation, je lui confie que maman tousse de plus en plus. Il m’explique :
— C ça la maladie de la cloche. L’air é pas korect ici. Moi aussi je tousse.
— Ça se soigne ?
— Oui, mé faut du flouze. Moi, ma mère elle a pas supporté.
Il a dit ça avec beaucoup de naturel, sans frémir de la voix, mais ses yeux se sont étirés derrière son foulard.
— Pas supporté ?
Il élude ma question, pose gentiment sa main sur mon épaule et me dit :
— Le flouze, C toujours le flouze ki soigne bien ici.
Il me fait flipper, moi aussi je veux du flouze. Avec Coz, nous nous sommes chaque jour éloignées un peu plus du quartier déshérité, celui des pouilleux, pour nous aventurer vers celui des flouzeux, les bourgeois d’ici. Ces gens-là, descendants d’investisseurs de la première heure, ont le monopole sur l’exploitation des indomptables, des diamants roses qu’on ne trouve que sur Titan. Plus on avance dans ce quartier, moins il y a de bruit et d’agitation. Y’a même une barrière avec un gardien. Il s’appelle Flamy et il est sympa avec nous. Il fait un peu la pluie et le beau temps ici, en décidant qui peut passer ou non. Il a sa vision du spot, il trouve qu’on matche bien, on est jolies et propres, bien éduquées. Il raconte aux habitants qu’on est ses cousines et qu’on vient d’arriver.
Nous restons postées discrètement à l’entrée du secteur où Flamy nous laisse tranquilles. En réalité, les Titaniens ne sont pas bien méchants, juste un peu revêches, désemparés de voir la misère gagner leur cité. Et toujours cette même question :
— Pourkoi kils nous envoient autant de Terriens ?
Flamy a une bonne tête, il a l’âge de Coz environ, soit trois de plus que moi et une tâche de vin sur la joue. Difficile de donner un âge aux locaux parce qu’ils grandissent énormément et la hauteur de leur taille n’est pas proportionnelle au développement de leurs émotions. À part Cerk, peut-être. Il est plus jeune que moi mais il a déjà souffert comme un grand. C’est pas qu’il est sérieux, c’est qu’il réfléchit tout le temps, du coup il parle peu. Flamy, c’est tout le contraire. Il est intarissable, d’autant qu’il est seul devant son portail toute la journée. Du coup, quand Cerk s’amène, il lui raconte sa vie. Pendant ce temps, on en profite pour s’avancer un peu dans le quartier déshabité.

— Take Ur time, nous a expliqué Cerk, ces men aiment kon les écoute. Ils seront généreux.
Drôle de nom ce quartier, mais c’est vrai qu’y a presque personne dehors. Par contre, les gens qui circulent sont généreux. C’est un nouveau quartier en fait, construit sur un plan circulaire, à côté du quartier historique qu’ils ont abandonné aux plus pauvres. L’architecture, c’est tout et n’importe quoi. Je m’y connais pas trop mais je sais quand même faire la différence entre un style antique à colonnes et une maison à la Corbusier. Le grand écart. Des maisons construites à la demande me dit Flamy, sur plan. J’avoue qu’au début ça m’a laissée perplexe, mais après on s’y fait.
Des hommes s’arrêtent pour discuter un bout et nous prennent en pitié. Tout est vrai dans ce qu’on raconte, sauf qu’on ment sur notre lien de parenté avec Flamy. C’est pas bien méchant comme mensonge et ils aiment qu’on leur raconte tout.
— Comment c’est sur Terre ? Pourquoi vous êtes là ?
Alors, on raconte. Ils aiment bien l’histoire de l’explosion. Papi m’a décrit le paysage tel qu’il l’avait connu enfant, avant le grand hiver volcanique. Comme il avait étudié la géologie à l’université, il s’y connaissait en éruptions et les autochtones adorent mes descriptions pleines de détails qu’ils ignorent.
— Ils ont tous entendu un grand boum ! je commence. Comme si on venait de bombarder le pays. On dit que le bruit de l’explosion a été entendu à plus de mille-cinq-cents kilomètres de distance. La colonne de cendres s’est élevée à près de trente-cinq kilomètres de hauteur, aussi longue que la distance qui nous sépare d’Aix.
— Tu l’as entendue, toi ? me demande un riverain.

Le gars a des lunettes de réalité augmentée, un habitué. Avec Coz, on l’appelle monsieur Real. Il fait partie des addicts, de ceux qui ne peuvent plus se passer de mes récits sur la Terre et le temps d’avant. Il est subjugué par l’idée qu’il a existé une époque sans ciel gris. Je lui parle de l’été, de cigales si énormes qu’on les accrochait aux murs des maisons pour décorer. Sous ses grosses lunettes, on voit ses yeux bleu ciel sous un front plissé par le doute. Il a perdu son fils, comme ça, du jour au lendemain. Pschit ! Il s’est écroulé et il est mort. Il avait une maladie rare, il paraît. Je renchéris à propos des cigales :
— À l’époque, il y en avait de partout et elles arrêtaient pas de chanter !
— Tu les as vues ?
— Non, c’était avant l’explosion.
— Et ton papi, il a vu l’explosion ?
— Il l’a entendue. Ce que je sais surtout, c’est que l’explosion a été plus puissante qu’une bombe atomique.
— Impossible !
— Si, c’est vrai !
— T’es pas en train de me charrier, là ?
— Non, j’vous jure !
Il s’abaisse pour se mettre à mon niveau et j’affirme sans ciller :
— L’éruption, elle a été plus de cent fois supérieure à celles des bombes d’Hiroshima et de Nagasaki réunies ! C’est mon pépé qui me l’a dit. Il a fait des études en géologie.
Il écarquille les yeux, stupéfait par les proportions improbables du cataclysme.
— C’est sûr, il mentait.
Je suis vexée.
— Mon papi mentait jamais !

Monsieur Real a une voix un peu cassée, comme s’il la retenait, et un fort accent local. Mais il ne parle pas le novandais, l’argot d’ici. Je suppose que l’accent compense son langage châtié, c’est sa façon de s’intégrer. Puis, il contemple le ciel bas, gris et pesant de Titan. Il est grand, mince sans être maigre. Il n’a aucun charme avec des cheveux jaune paille, rêches et une peau asséchée. Mais il est gentil avec nous. Grâce à moi, pendant cinq minutes, il a rêvé. Ça se voit qu’il s’évade. Coz, avec un sourire angélique, tend son poignet contre lequel le bracelet du gars vient se coller. Je poursuis, en l’accompagnant sur la route.
— Avant le grand hiver, les mois de juin étaient doux, c’était le début de l’été, on se baignait dans la rivière dont je vous ai parlé.
Je le vois alors regarder tristement l’horizon bouché par les nuages bas et poursuivre son chemin, alourdi par une frustration nouvelle. Après l’avoir laissé dans sa solitude, je lui pose la question qui me taraude :
— Pourquoi vous êtes triste ? Vous êtes heureux ici, non ? Vous avez des médiènes, nous on n’a plus de travail. Depuis ces événements, notre famille s’est appauvrie. Le prix du pain, des fruits et des légumes a triplé, sans parler de la viande. Il n’y a plus d’alcool sur Terre, le vin est aigre et mon arrière-grand-père n’a pas pu travailler le sol des vignes tant il avait plu ! Ensuite, notre village a connu la disette.
— Oui, mais vous aviez la vraie nature et de l’air ! C’est ça qui compte, non ? Vous étiez pas mieux sur Terre ? Franchement, je suis médecin et je vous dis : l’homme n’est pas fait pour grandir hors sol. Ici, on fait plein de carences. Je vois de tout à l’hôpital.
Monsieur Real s’arrête et embrasse nos fronts. Pour sûr, il en redemande et je lui raconte le coup de la chasse aux écureuils. J’explique qu’au début, Coz venait avec nous. Je l’encourageais à nous suivre et à contourner les obstacles glissants mais elle nous retardait et faisait comme exprès du bruit en écrasant des branchages. Papi avait fini par lui demander de rester à la maison. C’est pour ça que c’est surtout moi qui raconte nos excursions.

Je vois le moment où il se met à pleurer. D’instinct, je pose une main sur son dos pour le consoler.
— Vous savez à Paris, j’ai vu des voisins manger des cafards. Mais ça, nous on n’a jamais pu. C’était cruel de tuer mais on était en bonne santé.
Ça lui a remonté le moral tout de suite. Les cafards, ça l’a bien dégoûté, il doit y en avoir ici aussi.
La fois suivante quand il revient, je lui raconte la disette, pour qu’il comprenne mieux la chasse. Maintenant, monsieur Real s’assoit carrément avec nous sur un banc, pendant que je l’inonde de souvenirs qu’il fait siens. Il me dit qu’il consigne tout par écrit et qu’après, il lit mes récits à ses invités. Un vrai succès. C’est un client assuré car, sans nous, ses soirées vont décliner. Il nous a expliqué qu’il se lançait en politique car le Grand Renouvellement approchait. Il veut devenir gouverneur de Titan et pour ça, il doit organiser des soirées mondaines. C’est là qu’il raconte à ses invités tout ce que je lui dis. Alors, ça m’encourage, il aura besoin de moi longtemps et mes souvenirs sont nombreux.
— L’année qui a suivi l’irruption, je lui explique, papi a dû arrêter ses études pour aider ses parents à la ferme. Au marché, les paysans vendaient leurs patates à un prix exorbitant. Parfois, des clients s’énervaient et renversaient les étals, les mendiants en profitaient pour tout voler.
— Ça lui a pas fait trop de peine d’arrêter les études ?
— Si… Je crois qu’il aurait aimé continuer. Mais il a fait ce qu’il fallait. C’est ce qu’il m’a dit.
— Oui, il a raison ton papi. La famille c’est important.
Il enchaîne sur une nouvelle question :
— Et l’air, il était comment ?
— Vivifiant, je réponds sans hésiter. Pur et glacé. On faisait beaucoup de buée en respirant.
— Tiens ?
Il me fixe, puis le note sur un carnet, ça a l’air important. Quand je regarde monsieur Real, je me dis que les sauvages c’est nous. Il est si gentil et attentionné, et nous on profite de son argent. C’est vrai qu’il est laid avec sa peau qu’on voit au travers. Mais il est pas méchant. Faut dire aussi que monsieur Real n’est pas parti à la guerre parce qu’il était pro-Terrien. Il s’est enfui en attendant que ça se tasse. Tous les flouzeux ont fait comme lui.
— Vas-y, raconte-moi comment ton papi a aidé ses parents.
— Ils étaient trop vieux pour apprendre à chasser, je lui dis. Les pauvres comme nous allaient dans la garrigue cueillir des herbes, ensuite on les faisait cuire et on les hachait comme du chou pour les manger.
— Je déteste la soupe !
Il rit. Un souvenir tombe sur moi comme la foudre.
— Tenez, je m’écrie. Une fois, mon grand-père m’a montré un champ dans notre vallée. Il m’a dit « Là, on a retrouvé deux enfants morts ». J’ai vu comme dans un mirage les deux fantômes sur le sol, au loin.
— La faim ?
— Oui, les pauvres. Eux n’avaient pas de famille.
— La famille, c’est important.
Nous jouons comme ça les conteuses, en cillant des paupières. Tatie en personne nous enseigne la façon de mettre nos charmes en avant, les cheveux lâchés, les yeux discrètement maquillés, notre poitrine serrée dans un linge qui la compresse. Cerk nous a trouvé deux combis à la mode titanienne. Moches, quoi. Mais au moins on se fait pas repérer à des kilomètres.
— T trop belle ! avoue Cerk à ma cousine, une fois sa combi passée.
— On dirait une indigène, je constate, abasourdie.
— Carrément ! jubile notre ami.
Je le regarde, il a un sourire qui fend son visage émacié. Il a bon goût. Coz est un fruit délicat, avec une peau fragile, destinée au pays de la nuit. Meant to be here. Mais je sais pas comment tatie va réagir. Elle est un peu raciste et un peu flouzeuse aussi. Or, Cerk n’est ni Terrien ni riche.

Nous revenons près du bar les bracelets pleins de médiènes et les bras remplis de cadeaux de nos admirateurs. Coz et moi gardons toujours un petit quelque chose pour Cerk. C’est quand même grâce à lui qu’on a trouvé ce spot et en plus, pendant qu’il distrait Flamy, il fait pas la manche. C’est pas grand-chose mais ça devrait tout de même améliorer son quotidien. Certains soirs, il nous rejoint au moment de la lecture. Il s’assied toujours à côté de Coz, et il déchiffre avec elle un morceau de poésie. Tatie fait la grimace mais le garçon est une bonne personne, alors elle laisse faire. Pour lui, maman a choisi Rimbaud, un marcheur et un rêveur. Il ânonne, déchiffre péniblement quelques mots. On souffre tous en l’écoutant martyriser la grande poésie française. C’est un massacre et pourtant il est content de lui, assez fier de montrer qu’il sait lire. Ensuite, il arrête ses efforts et écoute la lecture que nous faisons à notre tour. Au début, il nous écoutait sans travailler. Mais après un mois de pratique, je crois qu’il suit vraiment ce que nous racontons. Il met en image les aventures qu’on lit, aussi incroyables que vraies.

— La promesse de l’aube, C bo ce titre, dit Cerk. Mé l’aube C quoi ?
— L’aube c’est quand le soleil se lève, répond Coz. Tu te souviens du poème de Victor Hugo ?
Il acquiesce puis se renseigne en plissant ses sourcils qui dépassent de son foulard :
— Y’a une aube sur Titan ?
Coz me regarde, interloquée, elle n’a pas réfléchi à la question.
— Le soleil se lève partout, répond tatie. C’est juste que sur Titan tu ne le vois pas. Mais, il est là, derrière la brume.
— Alors, je verrai l’aube pour mes 28 ans.
— Ah ?
Je crois que nous avons toutes calculé mentalement l’âge de Cerk pour deviner en quelle année TE nous verrions l’aube sur Titan. Il a onze ans et on est la troisième année du temps zéro, depuis la fin de la Guerre du Split. Ce sera pour l’an 20. Il poursuit :
— Sur Titan, C le printemps tous les 30 ans. C aussi le bachelor day. Y’a une big party, Vous, vous dites « célébration ». Il a mimé les guillemets avec ses doigts.
Ses yeux se mettent à divaguer comme s’il cherchait à se représenter cette aube qu’il ne connaît pas. Son visage tendre s’illumine, l’idée lui plaît. La lecture est finie, c’est l’heure du coucher. Cerk va nous abandonner car il n’a pas notre biorythme, il est incroyablement endurant à l’étirement du temps. Je dirais qu’il a un demi-cycle de veille en avance sur nous. Ma tante et ma mère nous abandonnent pour se rendre à la laverie mais je vois que Cerk fait semblant de parler à son trans. Quand elles s’éloignent, il revient nous faire la bise et Coz reçoit son premier baiser. Pourquoi je l’ai pas vu venir ? Et comment ils vont faire avec tatie sur le dos ? Jamais elle ne l’acceptera dans la famille. Trop pauvre, trop autochtone. Un sauvage, comme elle l’appelle. Pourtant, leur peau et leur cœur sont assortis, ils matchent comme disent les gens d’ici. Quand la vraie nuit tombe sur Titan, la peau diaphane de Coz semble plus mate que celle de notre ami dont je peux voir les traits du visage comme en plein jour.
Désormais Cerk et Coz trainent tout le temps ensemble. Les parents voient bien leur manège même si le couple reste discret. Tatie doit sûrement se dire que c’est platonique. Sa présence l’arrange bien car il la renseigne sur les us et coutumes des Médians. Je fais la quête quasiment toute seule pendant que les tourtereaux roucoulent près de Flamy qui a toujours dix mille choses à raconter. C’est le moment que choisit Angelo pour réapparaître et je ne peux m’empêcher de penser que ce n’est pas un hasard. Les garçons ont une certaine déférence pour lui car il peut les faire entrer dans un réseau de grounders. Finis les boulots à la petite semaine. Intégrer la Barns Ltd, c’est être assuré d’un bon petit matelas pour sa retraite. Et le flouze ici, il achète tout, même l’amitié.

Je suis au bord de la route et je vois qu’Angelo jette un coup d’œil vers moi depuis la barrière que garde Flamy. Il n’a pas besoin de laisser-passer pour entrer et il se dirige droit sur moi. Je lui souris, l’air distant cette fois. Il prend de mes nouvelles et je lui montre le butin de la matinée. Ici, l’important c’est pas comment tu gagnes ta vie, c’est de se lever le matin pour travailler. Le reste importe peu. Il me sonde nonchalamment.
— Et pour le logement ?
À cette question, je m’assombris.
— Tatie n’avance pas dans ses démarches.
— Il vous faut un protecteur.
— C’est quoi ?
— Je peux le faire. Dis-le à ta mum.
Il a énoncé ça en m’adressant un nouveau clin d’œil puis m’abandonne. Le salaud, il joue avec moi. Coz me fait un petit signe avec malice. C’est vrai que j’ai besoin d’un ami moi aussi, d’être heureuse. Lorsque Coz et moi rentrons le soir, je prends des nouvelles du dossier d’immigration.
— Il est presque bouclé, me confirme tatie, il ne nous manque plus qu’à trouver un parrain.
— Angelo peut le faire, je m’ écrie. Je l’ai croisé aujourd’hui.
Leur réaction me déçoit. Les deux sœurs se regardent l’air entendu sans me répondre. C’est injuste, elles se méfient d’Angelo quand c’est Cerk qui sort avec la couse.
Quelques jours plus tard, après notre mendicité, je vois ma mère et Pier en grande discussion sous la tente qui nous sert de foyer. Elles nous apprennent la bonne nouvelle.
— Angelo a proposé de nous aider.
— Je vous l’avais dit !
— Nous allons quitter la rue ! s’emballe Coz.
— Du calme, la sermonne maman. Ce n’est pas si simple.
— Pourquoi ?
— Il y aura une contrepartie à ce geste délicat.
Nous n’avons plus eu le droit d’aborder le sujet et nous avons pris notre repas dans un silence gêné. Notre parrain, cependant, est revenu voir ma mère dès le lendemain, pendant que nous faisions la quête. Tatie nous raconte que maman n’y est pas allée par quatre chemins. De toute façon, il est inutile de faire perdre du temps aux indigènes et mieux vaut être direct.

— Que veux-tu en contrepartie, Angy ? elle a demandé.
Il a pris un air offusqué pour déclarer, main sur la poitrine :
— Missis Pricard, with all respect, I already protect U. Je paie le loyer.
— Quel loyer ? Nous dormons dans la rue !
— Et C une taxe que je paie à la ville.
— Pour ce taudis, tu rigoles ?
— In fact, missis Pricard, je vous protect depuis votre arrivée.
Maman était restée comme deux ronds de flan, plus rien ne l’étonnait.
— But, y’a de nouveaux people dont je dois m’occuper. Z’ont besoin de votre seat pour dormir, C leur tour.
— Angelo, que veux-tu exactement ?
— Je voudrais que vos girls fassent entrer des médiènes dans ce bar.
Il a désigné du doigt le logo en torsade accroché au mur de régolithe.
— Ce bar est à toi ?
— Let’s say, je fournis la boose.
— Et qu’attends-tu de nos enfants ? Je te préviens, a lancé maman, leur virginité n’est pas à vendre.
Notre protecteur s’est levé et a fait mine de partir, vexé.
— C’est bon, c’est bon ! s’est exclamée tatie, décontenancée. Reviens Angy, excuse-nous. Dis ce que tu as en tête.
Il est revenu s’agenouiller auprès de ma mère.
— Ok, you’ll see. Au lieu de traîner dans la rue all day long, je voudrais que vos girls poussent les clients à boire davantage. Nice ! C’est pas une vie pour des jeunes filles bien de faire la manche comme ça. Il leur faut un vrai taf. Un taf honnête. Missis Pricard, faut que je vous dise. J’apprécie beaucoup votre fille. Je veux faire quelque chose pour elle. Laissez-moi vous protéger. Si ça vous convient pas, on quit.
Il avait l’air bouleversé nous a dit tatie, et sincère. Maman s’est retournée vers sa sœur qui a demandé :
— Et dans combien de temps aurons-nous un logement ?
— One month, le temps de checker le parrainage.
D’un hochement de tête, maman et Pier ont scellé ce qui, pour Cerk, ressemble à un pacte avec le diable. Moi, je suis ravie car c’est officiel. Angelo a avoué qu’il m’aimait bien. Cerk m’a expliqué qu’il voulait préserver ma virginité pour lui seul et que donc, il ne m’arriverait rien dans ce bar. Il était plus inquiet pour Coz et il a promis de venir nous surveiller dès qu’il le pourrait avec Flamy. Mais, pour ça, il lui fallait du flouze.

Trois semaines d’insultes quotidiennes, qui nous ont paru trois ans. Nous ne sommes pas à l’aise parmi ces adultes et ça se voit. Des marins saouls qui puent l’alcool demandent à être resservis et en profitent pour tripoter nos fesses ou nos seins, sans vergogne ni retenue. Cerk dépense l’argent qu’il gagne à boire des pots dans l’établissement avec Flamy. Pendant que ma cousine les sert, les clients la laissent tranquille. Moi, je suis intouchable, c’est chasse gardée mais ça ne les empêche pas de me caresser dès qu’ils ont un coup dans le nez. On les appelle des marins parce qu’ils travaillent dans le désert sur des mers de méthane. Mon carnet de croquis ne me quitte plus, je griffonne sur ma feuille-écran des figures prises sur le vif qui mettent de la distance avec tout ça. Surtout, je pense à ma mère dont les bronches sont encombrées et au besoin urgent de nous trouver un toit. Ça me donne du courage. Un mois, je dois tenir un mois. Je suis exténuée par le bruit, l’activité du bar qui ne désemplit jamais, comptant les jours, mais Angelo reporte constamment le moment de notre relogement.
Il a pris de l’assurance et vient parfois avec des copains dont la présence calme les ardeurs des buveurs de macis. Je m’étonne du toupet des habitués. Ne sont-ils pas mariés ? Ne voient-ils pas qu’on a l’âge de leurs filles ? Il faut dire qu’ils ne sont pas très futés. Ce sont des hommes grossiers, sans passé ni avenir, qui boivent leur solde pour oublier leur misérable vie. On parle de prohibition, les épouses se plaignent de ne pas voir la couleur des médiènes. On parle aussi de suicides, la vie dans le désert serait dure pour les célibataires. La solitude s’ajoute à l’isolement.
C’est l’heure de ma pause, je prends une place à côté de Cerk et Flamy.
— Et le logement ? demande Flamy.
— Il y a toujours des complications administratives.
— C fé com’ exprès, suggère Cerk en fixant son verre.
— Comment ça ?
Il lève une main défensive et tourne la tête vers la fenêtre pour éviter de me regarder. Je dois méditer là-dessus.
— Tout est calculé, précise Flamy.
Lui, me fixe droit dans les yeux, il essaie de me faire passer un message. Je sais que c’est un lieutenant d’Angelo. Il sait tout et ne me dira rien. La pause est finie, je dois reprendre le travail. Le soir, alors que Coz et moi nettoyons la salle, je m’écroule, en larmes.
— Plus on essaie de sortir de la misère, plus on s’y enfonce.
Je recherche en vain du réconfort auprès d’elle, mais Coz aussi est éreintée.
— Ma mère me répète qu’il ne faut pas vendre nos charmes et qu’ils seront plus utiles à un bon mariage.
— Oui, mais ma mère à moi est malade, Coz ! Si je veux la sauver, je vais devoir… Tu sais.
Cerk et elle ont bien compris ce qu’Angelo attend de moi. Elle me prend dans ses bras pour me consoler, comme une grande sœur.
— Il me plaît, je lui confie, mais j’aurais aimé que les choses se passent autrement.
Elle démêle une mèche de mes cheveux longs, je renifle.
— De façon plus romantique ?
J’acquiesce.
— J’aurais voulu qu’il me courtise, qu’il me flatte et que je me sente unique.
— Comme Cerk avec moi.
— Au lieu de ça, Angelo discute mon prix avec ma mère comme un vulgaire cab.
— Coutume locale a expliqué Cerk.
Angelo vient de faire son entrée. J’essuie mes yeux et Coz me laisse pour reprendre le nettoyage des tables.
— Le gouverneur va renvoyer les mendiants dans le désert.
Je me suis redressée sur ma chaise et j’ai senti, sans même la regarder, la couse se crisper. Coz sort en courant. Je murmure :
— Il peut pas faire ça !
Il s’accroupit devant moi, pose son arme sur une chaise, je la regarde sans la voir.
— Ta tante m’a supplié de faire vite.
Il se relève, s’accoude au bar et me regarde intensément, d’un regard dur que je ne lui connais pas. Je le trouve magnifique avec ses yeux clairs et pénétrants, il a changé. Cette fois, je sais ce qu’il me reste à faire. Je pose mon plateau, longe la console et me glisse derrière lui, pour disparaître dans le couloir où certaines filles, plus âgées, s’éclipsent avec des clients.

Le lendemain, Angelo et sa clique nous aident à emménager dans une pièce de onze mètres carrés, qui comprend une petite ouverture vers l’extérieur. Les voisins nous observent d’un œil suspicieux, la porte entrebâillée, quand nous montons les escaliers en rang d’oignon. Nos gars forcent le respect, nous ne serons pas embêtées. La chambre est exigüe mais nous débordons de joie. Seule maman n’ose pas me regarder dans les yeux. Il y a entre nous une discussion qui restera en suspens. J’ai pris une décision qui ne regarde que moi. J’ai grandi. Sous ses airs de canaille, Angy m’a traitée comme une princesse, il m’a fait sa déclaration. Je lui plais, il paraît que je l’ai envouté. Il m’a parlé de sa mère, il m’a raconté sa vie. Il m’a dit qu’il ne voulait plus me quitter. Je suis heureuse de l’avoir rencontré et fière de nous sortir de la rue, même si notre aventure n’a rien du glamour que j’attendais. Autres lieux, autres mœurs.
De la lucarne, une lumière douce tombe sur nous. Il fait sombre mais ça ne me perturbe pas outre mesure. Je vois la silhouette de maman à contrejour, le profil de Coz bien découpé et le visage radieux de ma tante. Nos affaires tiennent dans deux sacs minuscules, mais les garçons nous ont prêté quelques meubles que nous avons posés proprement. La figure épanouie de maman me fait l’effet d’un rayon de soleil, comme un fin liseré au-dessus d’une porte. Elle se met à rappeler des gestes anciens qu’on ne connaissait plus. Elle remplit un bol d’eau et le place dans un four. La pièce embaume le café à présent. Angelo a congédié ses associés, il ne reste plus que nous cinq.
— Assieds-toi, Angelo, tu l’as bien mérité.
Tatie, Coz et moi restons debout à regarder notre invité. Ça sent de plus en plus fort, comme dans une vraie maison. Elle propose :
— Du café ?
C’est à elle qu’Angy s’est toujours adressé. Ils ont tissé un drôle de lien, un lien étrange mais c’est mieux que rien. C’est même déjà quelque chose. On reste là à les regarder.
— Thanks, missis Pricard. J’suis happy ke ça vous plaise.
Il est fier et ça se voit, presque gêné. C’est la première fois que je perçois chez lui une expression d’humilité. Maman lui sert la première tasse et en place une deuxième dans le four.
— Oui, ça me plaît beaucoup, elle dit.
— Y’a plus de bruit ! remarque Pier.
Je m’étonne à mon tour :
— C’est vrai, le son de la rue a disparu.
— C’est paisible.
On s’assoit à notre tour et la pièce s’anime. Angelo me fixe intensément. Ici, c’est comme ça. Tout se mérite. Ce moment, c’est notre climax. Jamais, il n’avait été accueilli officiellement parmi nous. Pauvre ou pas, un voyou ne rentre pas chez les Pricard. Mais ce voyou-là nous a sauvées et il ne s’agit pas d’être ingrates. Angelo donne toujours l’impression de ne pas trop savoir ce qu’il veut mais, en réalité, il sait très bien où il va. Petit con ! Il n’aurait pas pu commencer par là, par la maison ? Eh ben non, je me dis. Car sinon, il ne nous tiendrait pas dans sa main comme il le fait aujourd’hui. Il construit, des relations, du territoire, des dettes. Ses liens à lui. Des liens forts, qui impliquent des sentiments, bons ou mauvais. Je vois maman lancer un regard insistant à sa sœur, en fronçant les sourcils. Quelque chose la contrarie. Pier regarde Coz qui reste en retrait.
— Va chercher Cerk, tu en meurs d’envie.
Ma cousine enlace le cou de sa mère avant de dévaler les escaliers en courant. La porte d’entrée claque, et au bout d’un petit moment on entend tousser dans les escaliers. Cerk est là lui aussi maintenant. Coz entre au bras d’un homme-enfant, plus grand, plus maigre et plus fragile qu’elle, la démarche élastique. En voyant Angelo, il fait un salut muet avec sa main, du front vers son ami qui hoche la tête. Les yeux de Cerk se plissent quand il prend la lumière dans la pénombre. Il ne voit plus rien et se protège les yeux de la main. C’est drôle d’avoir ces deux Titaniens dans notre nouveau chez nous. Ils semblent apprivoisés, ni vraiment installés, ni vraiment sur le départ, comme entre les deux. Alors maman sort son trans et l’active. Elle duplique les écrans et chacun de nous se retrouve devant une nouvelle page de Terre des hommes.

— Page 40, annonce-t-elle.
Cerk et Angelo se regardent tout penauds, on dirait deux petits garçons tout timides. Maman fait signe à Coz qui commence sa lecture.
— Dix minutes plus tard, j’avais décollé…
Cerk fait semblant de suivre les lettres sur les lignes, mais en réalité il écoute la voix du Griot qui lui raconte une aventure extraordinaire. Celle d’un aviateur qui survole la vieille Terre jusqu’à s’y écraser. Coz poursuit.
— Ce que j’ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l’aurait fait.
Et nous continuons ainsi. Les uns lisent, les autres écoutent, les mères surveillent.
Dans notre nouvelle maison, ça sent les pâtes fraîches, le pain et le macis. Maman y ajoute des saveurs artificielles comme celle de l’olive pour les pâtes et de l’anis pour l’alcool. Des choses gaies qui donnent à nos plats des tonalités claires.
— Ça entretient le souvenir du goût, explique tatie. C’est mieux que rien.
— Les hommes ne doivent pas oublier ! renchérit maman en nous servant chichement.
Pour Cerk et Angelo, ces saveurs-là sont nouvelles. Maman a eu l’idée de cultiver en intérieur des graines de pavot qu’Angelo a dégottées on ne sait où. On n’a pas demandé, il n’aurait pas répondu de toute façon. Tatie s’occupe des tâches ménagères et maman, très fatiguée, cuisine. La pièce dans laquelle nous vivons est conçue de façon ingénieuse. Deux paires de lits jumeaux s’encastrent dans le mur pour libérer de la place dans la journée et la cuisine ouverte permet de transformer un plan de travail en table à manger. Maman s’est rapidement familiarisée avec le mobilier et la technologie intégrée. L’endroit lui convient. L’argent que nous gagnons, Coz et moi, sert à payer la nourriture, les charges et les taxes. Mais, depuis que nous sommes sorties de la rue, nous n’avons plus droit à la soupe populaire et des tas de services deviennent payants. En fait, à la fin de la journée, il ne reste plus rien de ce que nous avons gagné, même pas de quoi aider Cerk. Mais au moins, il y a ce toit où il nous rejoint souvent. Ce toit qui le protège des petites choses comme la maladie et des grandes choses comme le vol ou la baston. Il ne va pas devenir honnête, les choses ne marchent pas comme ça à Médiane. Mais, à notre contact, il sera juste. Parce qu’on en parle et qu’il est obligé d’argumenter pour nous convaincre.

Cerk est un brave garçon, mais la guilde d’Angelo a de l’ascendant sur lui et ça ne plaît pas à tatie. Maman et elle se disputent, chacune cherchant à protéger sa fille. Au milieu, Coz et moi essayons de tempérer, mais je vois bien que Coz m’en veut. Comme si c’était de ma faute si Cerk fréquentait Angelo. Ils se connaissaient bien avant notre arrivée ici. C’est bête, on va finir par se déchirer pour des broutilles. Cerk ne rêve que d’une chose, être engagé dans une bande organisée et toucher un revenu fixe pour quitter la rue. Coz n’aime pas ce projet mais elle ne peut plus l’aider financièrement. De toute manière, Cerk n’aurait pas supporté plus longtemps cette situation. Il dit qu’ainsi il deviendra un homme et pourra épouser ma cousine.
Ce matin, tatie m’a adressé un vocatexte au travail. Maman a manqué s’étouffer et tatie a appelé le dispensaire Raffinon. Je l’ai dit à Cerk qui m’a expliqué que Raffinon était un flouzeux de la mine qui avait épousé en deuxième noce une éducatrice. Celle-ci l’aurait ouvert aux malheurs de la rue et incité à créer ce lieu destiné aux plus démunis. Cette éducatrice, c’est la mère d’Angelo. Je l’abandonne avec Coz pour rejoindre ma mère dans le bâtiment qui jouxte la Maison des Dames. On me guide jusqu’à son lit, sa fièvre est élevée, les nurses me parlent de bactéries, une pneumonie ou un truc comme ça. Je m’assieds près d’elle et j’écoute, anxieuse, sa respiration encombrée. Maman somnole bouche ouverte, sa gorge siffle et elle frissonne.
La nuit vient de tomber et nous avons ramené maman qui a dîné dans son lit et s’est endormie. Les garçons sont partis en grande discussion. Je crois qu’Angelo a quelque chose de sérieux à proposer à Cerk.
Dans la nuit, une voix plaintive me réveille. Je tends l’oreille.
— Ça vient du couloir, non ? demande Coz.
Un gémissement peut-être. Je me lève, incrédule, et fais quelques pas dans le hall où je découvre ma mère allongée dans son vomi. J’appelle tatie et me précipite dans les toilettes pour laver les traces par terre et rendre sa dignité à maman. Malgré le vacarme, personne ne sort voir ce qui se passe. Ici, c’est chacun pour soi. Pier aide sa sœur à se lever et nous la ramenons chez nous. Elle est si mal en point que je dois rappeler le dispensaire.
— Je suis désolée ! gémit ma mère.
— Tu dois arrêter de t’en faire ! la gronde tatie.
Je la questionne du regard.
— C’est pas la maladie ?
— Non, c’est le souci qui met ta mère dans cet état.
Coz se renseigne :
— Le souci de quoi ? Les choses s’améliorent, non ?
C’est là que nous avons appris la nouvelle.
— Le gouverneur vient de doubler la taxe sur l’oxygène.
— Quoi ?
Coz a poussé un cri et je suis tombée sur un siège.
— Nous travaillons déjà d’arrache-pied ! se plaint Coz.
— Ça nous replongera dans le besoin.
J’exhale un profond soupir, découragée, avant de me ressaisir.
— C’est exactement ce qu’ils veulent. Maintenir les gens d’en bas dans le besoin.
Je me lève pour éponger le front de ma mère avec un linge mouillé. Elle halète, elle fait peine. Là seulement, je réalise à quel point elle a vieilli. Ses mains tremblent, son regard s’évade et son visage est gonflé. Elle me regarde, perdue.
— Ça va, ça va.
J’enferme tendrement ses mains dans les miennes et je caresse sa peau douce pour la rassurer.
— Les secours vont arriver, lui dit tatie.
— Encore le dispensaire ? demande maman.
Je lui réponds aussi gentiment que je peux :
— Oui, ce sont des professionnels, ils vont t’aider.
Par peur qu’elle n’attrape froid à l’hôpital, je l’aide à enfiler des chaussettes.
— Tu vas pouvoir t’habiller ?
Elle acquiesce. Si j’avais su que je passais là mes derniers instants avec elle, j’aurais pris le temps de lui raconter plein de choses, de parler jusqu’à la saouler. Au lieu de ça, j’ai rejoint Pier qui regroupait des affaires.
— Tatie, je vais travailler de nuit pour pouvoir tout payer.
— Hors de question ! me gronde-t-elle.
— Je le ferai aussi, martèle Coz, d’un air buté.
Paf ! La claque vole dans toute sa violence et je regarde effarée la joue en feu de ma cousine. Tout part en vrille, je me dis, mais tatie ne s’arrête pas là. Elle déverse son fiel sur moi, on sent qu’elle s’est retenue trop longtemps.
— Tu as une très mauvaise influence sur Coz, je ne veux plus vous voir ensemble.
— Mais…
J’ai voulu ajouter « On vit ensemble » mais Pier ne m’en a pas laissé le temps d’en placer une.
— Tout ça c’est à cause de toi ! Tes mauvaises fréquentations, ta mauvaise vie.
— C’est faux !
J’élève la voix moi aussi, je ne vais pas me laisser faire. Puis, je me ravise car maman supplie :
— Arrêtez !
Je jette à ma tante un regard assassin avant d’entendre le son caractéristique de l’hospicab qui approche. Maman insiste en chuchotant :
— Promettez-moi de toujours rester soudées. Nous sommes une famille.
— C’est promis, maman.
Je suis rapidement dépassée par les événements. J’essaie de suivre, je monte avec les nurses mais je dois rester à l’extérieur, devant le dispensaire. J’attends une heure sans pouvoir la voir et finis par rentrer. J’appelle à deux heures TE, puis à huit et enfin à onze. Toujours impossible de la voir, on m’explique que la maladie de la cloche fait trop de ravages et qu’ils sont débordés. À treize heures, tout est fini. Fini.

Mon interlocutrice a le ton qu’il faut, ni trop dramatique, ni trop détaché.
— Vous avez de quoi payer l’enterrement ?
— Non, je chuchote.
— Et de quoi l’incinérer ?
— Non.
— Alors c’est la fosse commune, elle me dit.
— Vous allez la jeter ?
La personne que j’ai devant moi a une face ronde pas désagréable, d’âge mûr, les cheveux blancs et courts. Elle pince sa bouche et semble réfléchir.
— Rien ne vous empêche de faire une petite cérémonie.
— Je pourrai la voir ?
Nouveau pincement de lèvres, c’est mauvais signe. Elle est embêtée par ma question.
— Vous avez de quoi payer une chambre funéraire ?
— C’est quoi ?
— Un endroit pour vous recueillir devant le corps de votre maman.
Je fais non de la tête, je n’ai même plus la force ni l’envie d’avouer mon incroyable pauvreté.
— Vous pourrez venir avec des fleurs.
— Devant la fosse ?
— Oui.
— Et je les jetterai ?
— Oui.

Jamais je ne me suis sentie aussi seule de ma vie. Pendant que j’enterre maman, Coz et Pier sont censées faire la manche mais au lieu de ça, tatie s’organise pour se débarrasser de moi. Quand je rentre à la maison, le cœur vide, Angelo est là qui attend. Coz fait une drôle de tête, elle ne répond pas à mon salut. J’avais plein de choses à leur raconter, l’enterrement, la fosse, les fleurs. Mais au lieu de ça, Pier prend l’initiative.
— Assieds-toi, Chams.
J’obtempère, docilement.
— Tu vas épouser Angelo, il est grand temps.
— Déjà ?
Je suis en deuil, je n’ai pas l’esprit à ces choses-là.
— Tu as la chance de pouvoir faire un mariage, tu dois la saisir.
— Mais je croyais….
— Il n’y a pas de mais.
Je m’arrête. J’allais dire « Je croyais que tu n’aimais pas Angelo ». Elle me l’a dit mais je ne veux pas le blesser, il n’y est pour rien. C’est entre tatie et moi.
— C’est comme ça, un point c’est tout. Je ne veux plus vous voir aller et venir tous les deux dans cette maison. Vous devez fonder votre propre foyer.
— Mais cette maison, c’est moi qui…. Enfin, je veux dire, sans moi…
— Angelo nous a garanti que nous pourrions rester. Grâce à ton mariage, ta cousine et moi toucherons un petit pécule qui nous suffira pour vivre décemment sans faire la mendicité. C’est ce que tu veux pour nous, non ?
Je reste interdite. Ma réponse serait non. Je trouve pas ça juste de devoir partir et abandonner cette maison pour que ces dames aient la vie que je n’ai pas eue. En plus, cette maison, c’est grâce à moi qu’on y vit, parce que je connais Angelo. Elle insiste.
— Tu veux aider ta famille ou pas ?
Et le pantin que je suis hoche la tête, abdiquant son libre arbitre à une tante autoritaire et ambitieuse qui sacrifie sans vergogne sa nièce, alors que le corps de sa sœur est encore chaud.

Dernier cauchemar avant de basculer définitivement dans la folie. Cette fois la créature ne s’est même pas déguisée avant de se poster devant moi. Elle sait que j’ai renoncé à vivre et que je veux partir avec elle. Elle se tient à quelques centimètres de mon visage, je ne sais pas où je me trouve mais je sens son souffle. C’est presqu’un homme ou presqu’un lézard, selon comment on voit les choses. Elle est si près que j’entrevois mon reflet sur l’iris de ses grands yeux sans paupières. « Prends-moi », je luis dis. Là, certainement troublée, son apparence commence à se métamorphoser en de nombreux visages qui me sont familiers. Coz, Angelo, Pier, Cerk, papi, mamie. Tout va à une vitesse inouïe mais je parviens à reconnaître leurs traits. Je n’ai pas le temps de penser, je fixe ces visions fugitives quand, soudain, la transfiguration s’achève sur le visage, le seul, l’unique. « Maman ! » Elle ne dit rien, elle s’éloigne à reculons en me tendant la main. Je la suis, aspirée par le vide qu’elle laisse en s’éloignant, tel un chemin funeste dans lequel je lui emboite le pas.
